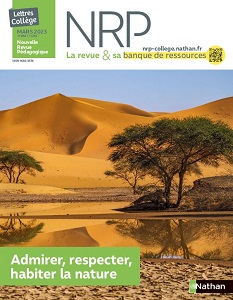https://classiques.ecoledesloisirs.fr/livre/CLA-Le-Tour-du-Monde-en-quatre-vingts-jours
Révision
mardi 17 décembre 2024
vendredi 22 novembre 2024
Le Fantôme de l’Opéra, de Gaston Leroux : labyrinthe et manipulation
Publié en feuilleton au cours des années 1909 et 1910, Le Fantôme de l’Opéra est sans doute le plus célèbre des romans de Gaston Leroux. Peuvent en témoigner les nombreuses adaptations cinématographiques dont le livre a fait l’objet: Rupert Julian2 (1925), Arthur Lubin (1943), Terence Fisher (1962), Brian de Palma (sous le titre Phantom of the Paradise, en 1974), Dario Argento (1998), etc. Comment expliquer la fascination exercée par ce roman sur des générations de cinéastes? Dans la plus pure tradition du roman populaire, Gaston Leroux a, certes, composé un récit fait de rebondissements spectaculaires, mais le principal attrait de l’œuvre réside sans doute dans la topographie qu’elle met en place. L’opéra Garnier, cet édifice un brin clinquant qui accueille les spectacles les plus prestigieux, auxquels se presse la haute société parisienne, est aussi un espace labyrinthique fait de portes dérobées, de souterrains et de chausse-trapes à forte valeur symbolique. En outre, rédigeant Le Fantôme de l’Opéra, Gaston Leroux remet à l’honneur un genre qui avait suscité l’engouement des lecteurs cent ans plus tôt: le roman gothique.
vendredi 15 novembre 2024
Lire Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, aujourd’hui, du collège au lycée
Il y a peu, j’ai demandé à mes élèves de première de lire un roman évoquant le thème de la marginalité. Ils avaient le choix entre une trentaine de titres parmi lesquels figurait le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. J’avais mis en garde les lecteurs peu entraînés. Il s’est malgré tout trouvé une demi-douzaine d’aventuriers pour explorer les arcanes du roman d’Hugo, cinq d’entre eux ont fini par abandonner. J’ai évidemment félicité la lectrice de fond qui avait effectué le parcours jusqu’au bout. Et, avec les autres, nous avons cherché les raisons de cet échec. La plupart ont évoqué le rythme du récit, une action qui tarde à démarrer, l’absence de héros ou d’héroïne immédiatement identifiable, les difficultés posées par une syntaxe parfois baroque, et la richesse d’un lexique un brin clinquant qui cherche la couleur locale. Bref, une écriture déroutante bien éloignée des standards d’aujourd’hui qui privilégient provocation et surprise. L’anecdote fait apparaître que la lecture de Victor Hugo, même en classe de première, devient difficile. Alors comment, dès lors, aborder ou faire lire une telle œuvre aujourd’hui ?
Confronté au problème, on songe tout de suite à l’ancienne pratique des morceaux choisis, Gallimard a d’ailleurs publié une anthologie[1] pertinente de Notre-Dame de Paris, commentée par Alain Goetz, lequel commence ainsi sa préface : « Hugo a interdit qu’on découpe ses textes en morceaux. En 1859, il écrit : “Les libraires [les éditeurs] qui, abusant du domaine public, tronqueront mes œuvres sous prétexte de choix, œuvres choisies, théâtre choisi, etc., etc., seront, je le leur dis d’avance, des imbéciles. J’existerai par l’ensemble.” Soit ! Hugo fait bien partie de ces « hommes océan », de ces génies dont il évoque l’existence dans la préface de son William Shakespeare. Mais il nous faut convenir que la plupart d’entre nous avons appris à nager en piscine, et l’on peut considérer que si des élèves de première n’en sont plus tout à fait au stade de l’apprentissage, on peut, sans remords, conseiller aux collégiens une anthologie ou une édition abrégée pour pallier la difficulté que posent longueurs et digressions dans les romans d’Hugo. Cela dit, il n’est pas pour autant certain que des collégiens parviendront à s’emparer seuls de l’excellente version abrégée de l’école des loisirs[2] (à laquelle nous nous référerons dans la première partie de l’article). Il faudra aussi que le professeur les aide, dessine des parcours, ait recours à la lecture à voix haute.
En cinquième : destins d’enfants trouvés
Notre-Dame de Paris est un roman qui convient parfaitement aux enjeux des classes de cinquième. La dimension historique autorise une approche interdisciplinaire, et le roman illustre avec pertinence l’objet d’étude « Avec autrui : familles, amis, réseaux ». Les deux figures héroïques du roman, la Esmeralda et Quasimodo, sont des « sans famille », des enfants adoptés. L’un et l’autre seront d’ailleurs cause de la ruine de leurs familles d’adoption respectives. Il est, dès lors, tout à fait possible de montrer comment se dessine ce double parcours dans le roman. La Esmeralda est immédiatement liée à la cour des Miracles dont elle constitue, par son innocence et sa pureté, un paradoxe et un motif de fierté. Le professeur peut lire à voix haute les premiers chapitres du livre II (pages 35 à 50) qui permettent de familiariser le lecteur avec la vision fantasmagorique que Victor Hugo donne à ce lieu. Il invite les élèves à lire le livre IV qui rapporte l’adoption de Quasimodo, et le troisième chapitre du livre VI qui raconte en quelles circonstances la petite Esmeralda (appelée alors Agnès) est enlevée à sa mère.
Il s’agit ensuite de montrer comment le romancier a tissé les fils croisés de deux destinées fatales, l’emprisonnement de la Esmeralda dans les tours de Notre-Dame suscite le soulèvement de la cour des Miracles et son anéantissement par les troupes du roi. L’amour désespéré de Quasimodo pour la belle bohémienne le conduira à balancer son père adoptif par-dessus les balustrades du haut des tours de la cathédrale.
jeudi 20 juin 2024
https://www.ecoledeslettres.fr/relire-matin-brun-de-franck-pavloff-un-phenomene-dedition-contre-lextreme-droite/
Janvier 1999, mon libraire (Bertrand, de La Nouvelle Librairie à Saint-Brieuc) me fait cadeau d’une plaquette de quelques pages, sortie il y a à peine deux mois. Un petit livre brun barré d’une croix noire et qui a pour titre Matin brun. Le nom de l’auteur, Franck Pavloff, me dit vaguement quelque chose, je l’associe à la Série noire ou au Poulpe[1], mais comme je ne suis pas un grand amateur de polars français, je ne le connais pas. Ce qui m’intrigue, c’est que ce soit Cheyne, l’éditeur de poésie, qui ait publié ce petit livre.
Bertrand, en me le tendant, me dit : « Lis-le. Je suis sûr que tu m’en achèteras d’autres… Pour les offrir. » Il n’avait pas tort. J’enseignais alors en lycée technique et professionnel, on m’avait confié des heures d’histoire, et il n’était pas rare, quand on abordait la Ve République, d’entendre un « Jean-Marie » lancé à l’encan. Petite provocation d’élève, pour voir… Jean-Marie Le Pen avait fait 15 % aux élections présidentielles de 1995, et sa petite entreprise continuait de progresser. Je ne relevais généralement pas les provocations d’élèves, mais les brèves discussions qu’on peut avoir parfois en fin de cours me révélaient que beaucoup de jeunes avaient cédé aux sirènes de l’extrême droite. Comment pouvait-il y avoir un tel décalage entre cette génération et la mienne ?
Ma génération était celle des enfants de la guerre. Mes parents avaient une dizaine d’années en 1945, le traumatisme laissé par la découverte des camps de concentration et l’horreur nazie étaient encore dans toutes les mémoires. Nos professeurs nous avaient fait lire Camus, Aragon, Sartre. Nous connaissions tous les dernières paroles de La Résistible Ascension d’Arturo Ui[2] (« Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde »). Nous avions tous en tête le final en demi-teinte de La Peste : « Écoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. »
Alors j’ai lu Matin brun en classe. J’ai parlé aux élèves de ces personnages de Charlie et du narrateur, deux braves types qui aiment siroter un café tranquille, jouer au tiercé, regarder la finale de la Coupe des coupes ou se faire une partie de cartes. Quand ils apprennent qu’une directive leur impose de tuer les chats et chiens qui ne sont pas bruns, ils le font, se disant qu’au fond, ce n’est pas très grave. Mais la politique de ségrégation ne s’arrête pas là : bientôt la presse libre disparaît, certains livres (« une affaire pas très claire » pour le narrateur) sont retirés des bibliothèques. Il devient prudent d’utiliser l’adjectif brun ou brune à la fin de ses phrases : « […] après tout, le langage c’est fait pour évoluer et ce n’était pas plus étrange de donner dans le brun, que de rajouter ‘‘putain con’’, à tout bout de champ… »
De compromissions en petites lâchetés, Charlie et son ami acceptent l’état brun jusqu’au jour où l’impossible se produit : ce sont les propriétaires de chiens bruns qui sont visés, puis tous ceux qui en ont possédé un. Charlie disparaît.
Je ne suis pas sûr d’avoir convaincu mes élèves de l’époque, qui, très pragmatiques, trouvaient absurde le programme de « l’état brun ». Mais qu’importe, le texte était accessible ; chez certains, il a fait mouche. Il a permis de montrer comment la mise en place d’un état autoritaire passe par des mesures qui semblent anodines, mais dont l’arbitraire est toujours significatif d’une menace.
vendredi 14 juin 2024
Parcours sur les émancipations créatrices : le voyage, source d’inspiration
La question de l’émancipation est au cœur de la poésie rimbaldienne, on a pu le voir avec la séquence que nous lui avons consacrée. Partant d’une poésie proche de la poésie parnassienne le jeune Rimbaud s’affranchit peu à peu des règles et tourne en dérision la figure du poète dans « Ma bohème ». Avec Une saison en enfer et Les illuminations, il adoptera la forme du poème en prose ou le vers libre pour manifester la trajectoire fulgurante d’un jeune homme qui traverse les aléas de l’existence en choisissant la démarche poétique pour idéal et en y renonçant pour vivre malgré tout. Au poète fugueur succède l’homme des grands voyages qui parcourt l’Europe à pied pour finir en Abyssinie. La thématique des voyages était au cœur de sa poésie, l’objet de notre groupement de texte sera d’interroger le lien que le poète semble susciter spontanément entre poésie et émancipation. Il s’agira donc moins d’interroger la question de l’émancipation formelle (qui peut néanmoins être abordée) que de s’intéresser à la manière dont les poètes envisagent le voyage. Pour rester dans le cadre du programme de première nous n’utilisons que des œuvres des XIXe, XXe et XXIe siècles.
Baudelaire, « Un hémisphère
dans une chevelure », Le Spleen de
Paris, 1869 ;
Laforgue, « Complainte
de la lune en province », Les Complaintes,
1885 ;
Mallarmé, « Brise Marine »,
Poésies, 1887 ;
Cendrars, ouverte de La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne
de France, 1913
Segalen, Poème LIII extrait
de Tibet (1919), 1979 ;
Yvon Le Men, « Dans le train qui va de Cluj-Napoca à Timişoara », Les continents sont des radeaux perdus, 2024.
On demandera en outre une
lecture cursive du recueil d’Yvon Le Men paru récemment aux éditions Bruno
Doucey, Les continents sont des radeaux
perdus.
jeudi 4 janvier 2024
mardi 2 janvier 2024
L'homme et l'animal dans les Fables de Florian, séquence pour les premières HLP
« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes », constatait La Fontaine dans sa dédicace au prince Dauphin. Une centaine d’année, Jean-Pierre Claris de Florian, petit neveu par alliance de Voltaire, fait un choix similaire. Et jusqu’au premier tiers du XXe siècle, Florian devait, à côté du génial La Fontaine, être considéré comme l’un des plus grands auteurs de notre littérature. L’histoire a ses revers et Florian, peu à peu, est tombé dans l’oubli. En proposant à des élèves de premières d’aborder son œuvre[1], on ne se contente pas de réparer une injustice (Florian est un très grand poète), on leur fournira aussi l’occasion de lire un genre populaire et spirituel, écrit dans une langue assez simple pour ne pas ternir le plaisir de la lecture.
Instruire les hommes, certes ! Mais l’animal n’a-t-il que cette fonction didactique dans la fable ? La sensibilité de l’auteur le conduit au-delà du topos et c’est bien à l’animal, en tant qu’être vivant qu’il s’intéresse. Représentation anthropomorphisée (« La Carpe et les Carpillons »), l’animal ne cesse de s’interroger sur sa valeur aux yeux de l’homme et ce questionnement permet de mettre en scène le théâtre de la cruauté sociale tout en portant les valeurs des lumières.
1. Florian et la poétique de la fable ;
2. La fable et le jeu de l’anthropomorphisme, étude de « La Carpe et les Carpillons » et de l’illustration de Grandville ;
3. La question de rapport de l’homme à l’animal dans les fables de Florian, étude comparée de quatre fables ;
4. Quand l’animal porte les valeurs des Lumières ;
5. La fable et le jeu de l’anthropomorphisme : quand la monde animal reflète les travers de l’humain : « Le Chat-huant et le philosophe ».
[1] On utilisera l’édition de l’école des loisirs, Florian, Fables, coll. Classiques, 2009, rééd. 2019.
https://nrp-lycee.nathan.fr/sequences/lhomme-et-lanimal-dans-les-fables-de-florian/
mardi 3 octobre 2023
Les Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaus, séquence première
À la recherche d’une langue nouvelle, Rimbaud utilise un lexique qu’il libère des exigences de bienséance propre à la poésie classique. Par les formes et l’esthétique, il emprunte aux Parnassiens, mais se rapproche du symbolisme, sans s’y associer complètement.
Séance 1. Rimbaud, une carrière poétique éphémère sous le Second Empire
Séance 2. «Ophélie» ou la tentation parnassienne
Séance 3. Quand Rimbaud s’exerce aux réécritures
Séance 4. Les maux de la guerre et de la religion, analyse linéaire du «Mal»
Séance 5. Le poète, contempteur de la société
Séance 6. «Ma bohème», les ambiguïtés d’un sonnet moderne
Séance 7. Tradition et innovation chez Rimbaud
Séance 8. Entraînement à la question de grammaire
vendredi 8 septembre 2023
Les neiges du Kilimandjaro de Joseph Kessel, séquence pour 4e
Présentation : Joseph Kessel qui fut l’un des grands reporters du XXe siècle est aujourd’hui surtout connu surtout pour ses œuvres romanesques, la plus connue est sans conteste Le Lion, qui fut l’un des grands succès d’édition de Gallimard, mais on lui doit aussi des romans qui ont fait l’objet d’adaptations cinématographiques populaires comme La Passante du Sans-souci ou Belle de jour. Le Paradis du Kilimandjaro qui servira de support à notre séquence est un recueil de quatre reportages initialement publiés dans le recueil intitulé La Piste fauve en 1954. Les deux premiers (« La Clairière aux pygmées » et « Les derniers Dieux du Nil ») rapportent le voyage qui conduisit un Kessel soucieux de découvrir la riche faune africaine aux alentours des sources du Nil près des chutes de Murchison. Les deux suivants évoquent son séjour au Kenya dans la réserve d’Amboseli, ces deux reportages portent aussi témoignages des acteurs, lieux et fait qui devaient inspirer la trame de son roman à venir, Le Lion, publié deux ans plus tard.
Les trois premiers reportages traduisent la fascination qu’a pu exercer l’Afrique sur le reporter qui s’émerveille des beautés d’une nature restée vierge. Dans un monde en pleine mutation, Kessel a parfaitement conscience du caractère exceptionnel des expériences que la terre africaine lui fait vivre. Chacun des trois reportages est construit comme un récit initiatique où, appréhendant la beauté surnaturelle du monde, le reporter narrateur semble renouer avec ses propres origines et trouver dans l’harmonie avec la nature un sens à l’existence. Le quatrième reportage, plus anecdotique, même s’il n’est pas dépourvu de toute dimension initiatique, rapporte les événements qui ont inspirée l’intrigue du Lion.
https://nrp-college.nathan.fr/sequences/joseph-kessel-le-paradis-du-kilimandjaro/
lundi 4 septembre 2023
Le Tour du monde en quatre-vingts jours, séquence 5e 4e
Le Tour du monde en quatre-vingt jours de Jules Verne est un récit plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Sa version abrégée s’avère particulièrement adaptée aux classes de collège. On peut viser, par son étude, le niveau cinquième dans lequel il est préconisé de « découvrir diverses formes de récits d’aventures, fictifs ou non » ou le niveau quatrième qui invite à aborder, « à travers des textes relevant des genres dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs portées par les personnages » et à « comprendre que la structure et le dynamisme de l’action dramatique ou romanesque, ont partie liée avec les conflits » de manière à faire saisir « les intérêts et les valeurs qu’ils mettent en jeu. » La séquence qui suit prend en compte ces deux aspects du récit, ajoutons qu’en quatrième elle pourra servir d’amorce à l’objet d’étude « Informer, s’informer, déformer ? », le périple de Phileas Fogg s’avérant riche en retentissements médiatiques ; tandis qu’en cinquième elle permettra d’aborder la question du regard sur « le monde », les héros verniens s’avérant particulièrement ethno-centrés. La séquence s’attache à montrer comment le roman d’aventures devient roman de formation, suscitant par là l’intérêt des jeunes lecteurs. Selon la classe dans laquelle le professeur abordera le roman, il mettra l’accent sur les éléments spécifiques au programme du niveau retenu.
In, L'Ecole des lettres, septembre 2023.
https://classiques.ecoledesloisirs.fr/livre/CLA-Le-Tour-du-Monde-en-quatre-vingts-jours
vendredi 28 juillet 2023
Le Tour du monde en quatre-vingts jours
« Un jour, dira Jules Verne à des journalistes, j’ai pris un exemplaire du journal Le Siècle et j’y ai vu des calculs démontrant que le voyage autour du monde pouvait se faire en quatre-vingts jours. » On imagine aisément quelle tempête sous un crâne put déclencher cette lecture. Faire le tour du monde en quatre-vingt jours devenait possible ! Pour l’écrivain qui aimait voyager et avait fait bourlinguer tant de personnages à travers le monde entier, s’offrait là, l’occasion d’une expérience nouvelle, inédite. Ses personnages auraient à jongler non seulement avec les obstacles géographiques mais aussi avec les impératifs temporels.
Effectuer le tour du monde en quatre-vingts jours en 1871 était de fait une performance qui pouvait manifester le triomphe de la technique sur la nature et les éléments. Les chemins de fers, les lignes de paquebots qui traversent les océans permettent théoriquement d’accomplir cette prouesse, Jules Verne va en faire la démonstration romanesque. Mais faire le tour du monde en quatre-vingts jours c’est aussi, d’une certaine manière, dire adieu à l’aventure. Dans ses romans antérieurs Jules Verne a envoyé ses personnages dans les zones blanches du globe terrestre, qu’ils aient cherché à gagner le centre de la terre, ou à suivre le parallèle de latitude 37°11’ ! Le monde semblait inépuisable, le voilà désormais circonscrit.
L’homme qui accomplira un tel exploit se doit d’ailleurs d’être exceptionnel, il lui faut faire preuve d’une exactitude métronomique, quel meilleur sujet qu’un de ces britanniques méthodiques, routiniers et subitement excentriques que Jules Verne a pu observer au cours de ses voyages en Angleterre ? Phileas Fogg en sera la parfaite illustration : membre d’un club distingué, énigmatique et laconique, sa vie est réglée comme une horloge. Pour son nouveau serviteur, le français Jean Passepartout, Phileas Fogg est l’un de ces « anglais à sang froid », un « être bien équilibré dans toutes ses parties, justement pondéré, aussi parfait qu’un chronomètre. » Le serviteur inaugure, dans ce chapitre 2, la série des comparaisons et métaphores qui donnent à voir le héros du roman comme une machine.
(extrait de la préface)
Séquence disponible sur : https://www.ecoledeslettres.fr/fiches-pdf/le-tour-du-monde-en-quatre-vingts-jours-de-jules-verne-du-roman-daventures-au-roman-de-formation/
vendredi 24 mars 2023
La science en question dans Le Rayon vert de Jules Verne
Les « prolongements » aux lectures indicatives signalées dans Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019 suggèrent la lecture de l’un « Voyages extraordinaires » de Jules Verne pour illustrer la seconde grande thématique du programme : les représentations du monde. L’objet d’étude « Décrire, figurer, imaginer » semble si parfaitement caractériser l’œuvre de notre illustre romancier qu’il semble vain de chercher à justifier son utilisation en cours. Qui, mieux que Jules Verne, a su glorifier les vertus du progrès scientifique et la pensée positive dans les dernières décennies du XIXe siècle ? L’œuvre de Jules Verne est si bien assimilée au développement de la vulgarisation scientifique qu’on en a oublié qu’elle était avant tout une œuvre romanesque qui exalte l’imagination. Les instructions officielles invitant à explorer « le rôle de l’imagination et l’usage de la fiction dans le développement des savoirs sur la nature et sur l’homme », il nous a semblé intéressant de retenir une œuvre assez atypique du corpus vernien, Le Rayon vert[1], publié en 1862. La science y a certes sa place, et c’est en quête d’un mythe scientifique (le fameux rayon) que partent les protagonistes de notre histoire. Mais, elle y est aussi caricaturée, incarnée par un scientifique aussi sot que vain (le jeune Aristobulus Ursiclos dont le patronyme constitue à lui seul un programme) et finalement réduite au rang de faire valoir d’un imaginaire qui, prenant appui sur les croyances ancestrales de l’humanité, semble infiniment plus précieux que le discours desséchant d’un positivisme triomphant. L’œuvre pourra faire suite à l’étude d’un groupement de textes consacrés aux combats menés par Descartes, Kant et les philosophes du XVIIIe pour imposer le rationalisme dans l’Europe moderne.
https://nrp-lycee.nathan.fr/sequences/la-science-en-question-dans-le-rayon-vert-de-jules-verne/
[1] Nous utilisons pour cette étude la seule édition courante disponible du Rayon vert, le « Livre de Poche » n° 2060 publié en 2004.
samedi 10 septembre 2022
Olympe de Gouges enfin reconnue?
Les Droits de la femme et de la citoyenne a surgi dans la liste des œuvres au programme des épreuves anticipées du bac de français 2022. La vie de cette femme de lettres en lutte contre les oppressions et pour l’égalité est en elle-même un roman.
La figure d’Olympe de Gouges a longtemps été ignorée des manuels de littérature, et c’est à peine si l’histoire retenait son nom dans l’inventaire des trop nombreuses victimes de la Terreur. Or, voilà que son œuvre la plus connue, Les Droits de la femme et de la citoyenne1, surgit dans la liste des œuvres mises au programme des épreuves anticipées du bac de français 2022. Le choix peut étonner: l’œuvre intégrale fait à peine dix-sept pages dans l’édition retenue, et nous y englobons la «Dédicace à la reine» que les programmes n’invitent pas à explorer. Mais elle est évidemment emblématique ! Emblématique de l’entreprise et du destin d’une femme exceptionnelle dont la pensée, bien en avance sur celle de son temps, revendiquait une place pour la femme au moins égale à celle de l’homme et, qui par ses nombreux combats
contre l’esclavage et les oppressions de toutes
sortes, contre la tyrannie, rêvait d’une société plus égalitaire, plus humaine,
forte de cette humanité que les révolutionnaires de 1989 avaient, somme toute,
occulté.
Un destin romanesque
L'engagement révolutionaire
Oeuvres disponibles
dimanche 20 janvier 2019
Les « Contes », de Marie-Catherine d’Aulnoy, des contes de fées littéraires
 Une séquence pour la classe de 5e.
Une séquence pour la classe de 5e.Les nouveaux programmes de cinquième invitent, dans le cadre de l’entrée « Regarder le monde, inventer des mondes », à analyser au moins un conte merveilleux. L’œuvre de Mme d’Aulnoy, moins connue que celles de Perrault ou des frères Grimm, aura pour la majorité des élèves le mérite de la nouveauté. Elle permet, en outre, d’évoquer le siècle de Louis XIV, et rien n’interdit de réfléchir à la coïncidence qui existe entre la fin d’un règne marqué par le rigorisme et l’austérité religieuse et l’émergence d’un genre, le conte de fées, qui autorise toutes les fantaisies.
 Plan de la séquence
Plan de la séquence1. Situation des contes
2. L’ouverture du « Nain jaune »
3. L’intrigue du « Nain jaune »
4. La conjugaison du passé simple
5. Le dénouement du « Nain jaune »
6. Entrer dans le merveilleux avec » La Chatte blanche »
7. Lecture de » La Chatte blanche »
8. Analyse d’un extrait de « L’Oiseau bleu »
9. Synthèse et évaluation de l’oral
10. Évaluation
http://actualites.ecoledeslettres.fr/education/lecole-lettres-2-2017-2018-contes-de-fees-a-bande-dessinee-lire-rever-philosopher/
samedi 28 mai 2016
"Phrères" de Claire Barré
jeudi 3 décembre 2015
Le Retour à Salem d'Hélène Grimaud
 |
| Edition en Livre de Poche, 2015. |
jeudi 5 février 2015
"En Syrie" de Joseph Kessel
 Une expérience de la nostalgie
Une expérience de la nostalgie
Éviter de vivre en journaliste
Entre épopée et poésie
jeudi 22 mai 2014
René Daumal est mort, il y a soixante-dix ans
 René Daumal, c’est une trace, un sillon creusés dans la littérature et la vie. L’image est à la fois banale et paradoxale quand on sait que le poète est désormais surtout connu pour Le Mont Analogue, ce conte métaphysique inachevé, récit d’une ascension
Mais Daumal a bien creusé sa vie comme on creuse un sillon (versus), cherchant avant tout à être.
René Daumal, c’est une trace, un sillon creusés dans la littérature et la vie. L’image est à la fois banale et paradoxale quand on sait que le poète est désormais surtout connu pour Le Mont Analogue, ce conte métaphysique inachevé, récit d’une ascension
Mais Daumal a bien creusé sa vie comme on creuse un sillon (versus), cherchant avant tout à être. samedi 25 mai 2013
"Lettres familières" recueillies par M.-P. Batello
 Avec ce recueil de lettres familières, Marie Pérouse-Battello propose une anthologie de la correspondance privée rigoureusement composée et qui pourra se révéler utile dans bien des progressions didactiques pour le cours de français, que ce soit au collège ou au lycée.
Avec ce recueil de lettres familières, Marie Pérouse-Battello propose une anthologie de la correspondance privée rigoureusement composée et qui pourra se révéler utile dans bien des progressions didactiques pour le cours de français, que ce soit au collège ou au lycée. - See more at: http://www.ecoledeslettres.fr/blog/litteratures/lettres-familieres-de-ciceron-a-marcel-proust-reunies-et-presentees-par-marie-perouse-battello/#sthash.Sv7Q1ZHT.dpuf